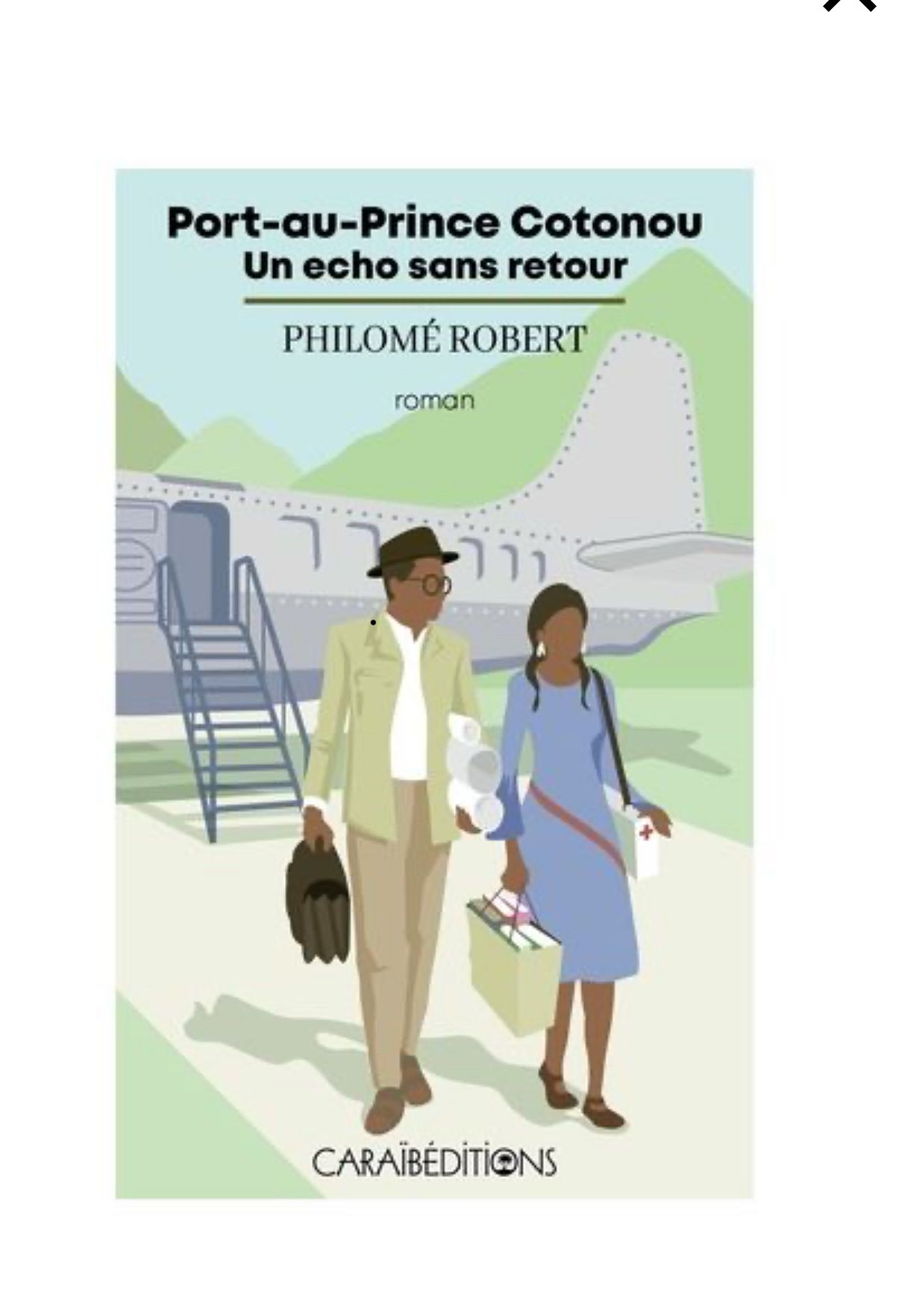
Par Maguet Delva
Je viens d’achever la première lecture du nouveau roman de Robert Philomé, Port-au-Prince Cotonou : un écho sans retour. Ce récit de 165 pages, découpé en 30 chapitres, nous entraîne dans une traversée humaine et sensorielle, où l’exil devient à la fois trame narrative et quête intérieure.
Au cœur de cette fresque, deux figures centrales : Léonce, le garçon, et Nortilia, la jeune fille. Autour d’eux gravitent d’autres personnages, tout aussi marqués par les remous du destin, donnant au roman une densité vivante, presque organique. Le livre fourmille de voix, de trajectoires, de rencontres comme un marché aux couleurs multiples où les récits se croisent, s’interpellent, s’entrelacent.
Une fois encore, Robert Philomé explore le drame de l’exil, mais ici, avec la grâce du romancier. Ce moi narratif qu’il insuffle à ses pages donne au texte une texture singulière, un relief sensible, fait de nuances, d’éclats, de blessures muettes et de tendresses fugaces. L’écriture coule comme une rivière tantôt paisible, tantôt tumultueuse, charriant des vérités humaines et des silences chargés de mémoire.
Et puis, au détour d’un chapitre, surgit parfois une image, une métaphore, un éclat poétique bien ajusté comme une perle tombée dans un carnet de reportage. Ce mélange subtil entre littérature et réalité vécue donne à l’ensemble une profondeur rare, presque troublante.
Ce passage s’ouvre sur un geste de rupture, presque théâtral : « Je prends la porte exactement comme sa folle d’héroïne ». Mais au lieu de se réfugier dans la plainte, le narrateur choisit l’extérieur, le mouvement, les rues vivantes de Porto-Novo. Il ne fuit pas pour s’éteindre, mais pour se rallumer dans l’espace — comme si la ville devenait une extension de sa propre pensée en désordre.
La déambulation dans Porto-Novo est une métaphore de la reconquête de soi. Chaque pas devient un acte de réancrage, chaque rue un fil conducteur vers un apaisement. La ville est personnifiée : elle console, elle rassure, elle absorbe les tensions. Elle est « ancre », mais aussi carte mentale, aux reliefs contrastés : venelles sombres, corridors imprévus, ouvertures soudaines. Ces lieux, à la fois familiers et imprévisibles, épousent l’état intérieur du narrateur comme une ville-miroir.
Le contraste entre les formes architecturales évoquées (traditions dahoméennes et méthodes occidentales) accentue cette tension permanente entre les origines, les héritages, les cultures qui se croisent comme si la ville elle-même portait en ses murs les fragments d’une identité éclatée, mais résiliente.
Puis survient Simone, apparition presque irréelle, couchée dans un sommeil profond « comme un coma ». Ce personnage sans nom réel (le narrateur l’a renommée, lui attribuant une identité choisie) incarne une solitude extrême, une chute silencieuse, une humanité en pause. Elle est une ponctuation dans la marche du narrateur, un rappel brutal d’un autre exil, celui des corps sans abri, des existences à la dérive.
Simone, emmitouflée malgré la chaleur, incarne l’absurde douceur des survivances, une sorte d’icône blessée, figée dans un sommeil plus lourd que la nuit. Elle contraste violemment avec l’élan du narrateur, mais elle l’ancre encore davantage dans sa propre humanité.
En somme, ce passage déploie une poétique de la ville comme refuge intérieur, un lieu où l’errance devient remède et où chaque visage, même endormi, rappelle la fragilité de l’existence. Porto-Novo est plus qu’un décor : c’est une conscience, un territoire du sensible, un espace d’apaisement où le chaos du dedans trouve enfin un peu de silence.
Ce roman est une invitation à franchir les frontières visibles et invisibles entre Port-au-Prince et Cotonou, entre passé et présent, entre l’ici et l’ailleurs.
Maguet Delva, Paris
- Log in to post comments













